Toute personne intéressée à partager sur notre site un compte-rendu peut le faire parvenir via notre formulaire de contact (https://didhis.ch/contact/).
Nous tenons à remercier tout particulièrement Monsieur Pierre Jaquet pour ses fidèles contributions !
Noëlle-Laetitia Perret :
Ermolao Barbaro. Humanisme et ambassade
Un remarquable ouvrage, consacré à une figure exemplaire de la Renaissance italienne, Ermolao Barbaro, vient d’être publié chez Alphil. Erudition et orientation pédagogique sont opportunément conciliées.
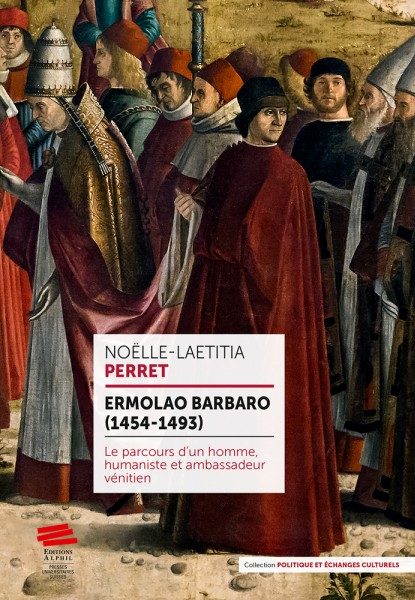
Qui est cet humaniste vénitien, objet de cette recherche, ayant vécu de 1454 à 1493 ? Noëlle-Laetitia Perret s’attache à en dessiner le portrait, cherche à en comprendre et à en expliquer les choix de vie, les motivations profondes. Mais le travail dépasse le simple stade biographique, et au travers de l’étude de ce personnage, l’investigation permet d’accéder au monde intellectuel de la Renaissance péninsulaire, à ses valeurs, à sa diplomatie.
Fait beaucoup trop rare et d’autant plus précieux, l’historienne met à disposition un important dossier de sources. Sa narration se veut immersive, sans que jamais l’on ne risque de se perdre dans des détails inutiles ou secondaires. La correspondance citée d’Ermolao Barbaro confronte le lecteur à des codes de la rhétorique du temps. Un imaginaire collectif et un assemblage de représentations se dégagent. L’universitaire ne cède jamais à la tentation de simplement raconter. Elle élabore un discours permettant de comprendre des relations diplomatiques, ainsi qu’un idéal politique et personnel.
Pour préparer ses cours, l’enseignant d’histoire peut ainsi atteindre un large spectre de connaissances, mais surtout il accède à un riche matériel lui permettant de transformer ses élèves en apprentis historiens. L’enjeu n’est pas mince.
Un portrait
Mais reprenons. De qui est-il question ? Ermolao Barbaro s’est expliqué ainsi : « Mes parents vivent les deux; ma mère est une Vendramin, fille d’Andrea qui fut doge et vénitien. […] De mes cinq frères, deux ont survécu. Mon grand-père paternel fut Francesco Barbaro, orateur de notre république et connaisseur reconnu du grec et du latin. Encore jeune homme, il écrivit un traité sur le mariage, de même qu’il traduisit les vies d’Aristide et de Caton par Plutarque. […] Et puis il y a un autre Barbaro, lui aussi de notre famille, dont tu as lu qu’il avait été ambassadeur de Perse. »
Ces lignes, tirées d’une lettre adressée à Arnold de Bost, théologien catholique flamand (13 avril 1486), résument la provenance familiale du personnage. Ajoutons que le père, Zaccaria, a fait partie de l’élite vénitienne et qu’il a été diplomate, comme son fils. Un tel contexte prédisposait Ermolao à devenir une figure de l’humanisme, et l’on comprend les motivations de l’historienne à s’y intéresser.
Une autre citation, extraite des « Epistulae », datée du 8 juillet 1484, trace le portrait psychologique : «…Il ne reste qu’une façon de pouvoir exister […] c’est que cette société de lettrés fréquente mon foyer. J’en jouirai donc, et je jouirai des plus honnêtes plaisirs…»
Les documents témoignent des idées et de l’engagement de cet érudit écartelé entre sa vocation pour les Lettres, le devoir de servir sa République, et sa préoccupation permanente de faire honneur à sa famille. Un idéal de vie transparaît.
Sur ces bases, Noëlle-Laetitia Perret réussit à peindre une large fresque des valeurs de l’époque, à propos desquelles a écrit le patricien, des actions diplomatiques auxquelles il a participé, des conflits entre papauté et institutions politiques dans lesquelles le Vénitien s’est retrouvé impliqué.
Quel parcours ?
Nous ne nous attarderons pas à décrire la biographie traitée. Mentionnons seulement quelques étapes : une enfance dans la cité des Doges, des études à Rome puis à Padoue où il devient professeur de philosophie en 1477. « Un cadre idéologique, politique et social » est ensuite exposé par Noëlle-Laetitia Perret. Elle convoque des textes antiques auxquels s’est intéressé le penseur. Dans les années 1480, l’homme exerce des fonctions diplomatiques, notamment à Milan. L’historienne dessine des enjeux et un portrait de l’ambassadeur tel qu’il veut être. En 1491, le pape Innocent VIII nomme le Vénitien au poste important de patriarche d’Aquilée. Par sens du devoir, ce dernier accepte cette fonction, mais le Sénat de sa ville refuse de ratifier cette nomination, le plaçant dans un conflit de loyauté. L’épisode s’inscrit bien évidemment dans la série de duels entre papauté et autorités civiles. Ermolao finit par renoncer et reste à Rome, recevant une pension du gouvernement pontifical : iI peut céder à sa passion pour les livres, jusqu’à sa mort (probablement de la peste) le 14 juin 1493.
L’analyse de cette vie renvoie bien évidemment à une multiplicité de problématiques dépassant ce champ d’investigation. Cela ajoute de l’intérêt à cette étude, laquelle s’apprécie, nous insistons sur ce point, aussi bien sur la grande valeur historique intrinsèque de la recherche que par les ouvertures didactiques qu’elle offre.
Pierre JAQUET
Université Populaire de Lausanne
Noëlle-Laetitia PERRET : Ermolao Barbaro (1454-1493), le parcours d’un humaniste et ambassadeur vénitien. Neuchâtel, Editions Alphil, 2024, 363 p.
Sous la direction
de Maurice Grünig :
L’extraction minière en terre neuchâteloise, une histoire méconnue

Une heureuse rencontre de la géologie, de la géographie, de l’histoire et de la pédagogie
Sait-on à quel point le canton de Neuchâtel possède un intéressant passé minier ? Un magnifique ouvrage traite de cette question méconnue, dans un style alerte et fluide – d’aucuns pourraient lui trouver une tournure « journalistique », au meilleur sens du terme – qui le rend plaisant à lire de bout en bout. Récemment publié par les Editions Alphil sous la direction de Maurice Grünig, ce livre se concentre bien évidemment sur les temps de l’exploitation des sous-sols, soit une période s’étendant du milieu du XVIIIe siècle jusqu’à l’après Deuxième Guerre mondiale. La publication nous laisse aussi entrevoir ce que tous ces lieux sont devenus depuis, et plus particulièrement l’abandon progressif dont ils ont été l’objet.
Cette investigation permet donc de cerner un aspect mésestimé de l’histoire neuchâteloise, et plus spécialement le destin inabouti – par la faute de la pauvreté de gisements devenus de moins en moins rentables – d’un secteur de l’industrialisation de la région. Faits et circonstances sont clairement indiqués. La présentation distingue les différent types de ressources exploitées : la chaux, le ciment, l’asphalte, le charbon et la pierre de taille.
L’ouvrage est très rigoureux dans son contenu, et la recherche historique menée avec soin. Mais son intérêt principal réside peut-être bien du côté des nombreuses illustrations révélatrices et bien choisies. Doté d’un tel matériau iconographique associé à une intelligente vulgarisation, ce livre conjugue une richesse des contenus scientifiques et une conception pédagogique bien pensée. Ce volume peut ainsi parfaitement servir de base pour un cours interdisciplinaire d’histoire et de géographie pour les établissements secondaires, tant les ressources didactiques, nous tenons à insister sur ce point, y apparaissent nombreuses et pertinentes. Dans les gymnases, il pourrait également inspirer des travaux de maturité.
Le cadre posé
Les deux premiers chapitres sont consacrés à la géologie du Jura. D’un exposé bien pensé ressort l’essentiel, et la lecture est facilitée par des schémas, cartes et documents iconographiques opportunément reproduits. La section suivante intitulée « un passé riche, mais pauvre » envisage l’étendue et les richesses – relatives – des gisements. Selon les périodes historiques, le potentiel a pu être grand – qui sait que, au XIXe siècle, le bitume de Paris a eu pour origine le sol neuchâtelois – ou se réduire. Après la Deuxième Guerre mondiale, les sites n’étant plus rentables ont été fermés. De nos jours, les bâtiments industriels ont disparu sous la recolonisation forestière, les galeries se sont souvent effondrées; la visite, au plus profond des corridors, est souvent fort problématique. Les photos mises à disposition pallient à cet inconvénient. Mais au moins un de ces endroits, « La Presta » à Travers, est devenu un musée, acquérant ainsi une sorte de nouvelle vie. Le quatrième chapitre évoque les techniques minières. Ses illustrations sont, là encore, le point fort.
Guide de voyage
Dans une deuxième partie sont présentés plus d’une dizaine de sites répartis sur l’ensemble du canton. Comment ne pas y discerner toutes les possibilités d’excursions sur le terrain qu’un ou une enseignant(e), souhaitant confronter ses élèves dans le concret, pourrait y mener ?
Chacune des différentes présentations, au gré des chapitres, est clairement structurée : les informations pratiques (dates, lieux, coordonnées géographiques, longueur des galeries) voisinent avec des commentaires plus élaborés. Pour qui souhaite repérer des traces dans le paysage, il est ainsi possible d’aller vérifier sur place. Des photographies anciennes et contemporaines permettent de mesurer les écarts chronologiques. Les plus récentes donnent l’impression d’une visite virtuelle « en direct » : Les amoureux des nouvelles technologies, ou les pédagogues, peuvent y trouver des QR codes permettant de récupérer les images, afin, par exemple, de pouvoir les travailler sur un écran d’ordinateur. L’ouvrage est donc bien « de son temps » !
On l’aura compris, pour des enseignants et des bibliothèques scolaires, une telle publication, que nous recommandons chaudement, nous apparaît tout à la fois passionnante et utile.
Pierre JAQUET
Université Populaire de Lausanne
Maurice GRÜNIG (dir). L’extraction minière en terre neuchâteloise, une histoire méconnue. Cahier 39 de l’Institut neuchâtelois, nouvelle série, Neuchâtel, Editions Alphil, 2024, 187 p.
Contributions de Yvan Matthey & Jacques Ayer (géologie du Jura) et Corinne Chuard (histoire)
On peut trouver un entretien avec Maurice Grünig sur le site de RTN (consulté le 8 décembre 2024) à l’adresse électronique suivante : https://www.rtn.ch/rtn/Actualite/Region/20240316-Au-coeur-des-mines-neuchateloises.html
Cédric Humair :
La Suisse et les Empires
Quand le petit poucet devient grand.

Cédric Humair est historien chercheur et enseignant. Sa dernière publication témoigne des préoccupations didactiques qui accompagnent sa rigueur académique: L’ouvrage traitant de la place de la Suisse dans l’international, pendant la seconde moitié du XIXe siècle, est tout à la fois rigoureux et opportunément synthétique.
La problématique invite à réfléchir sur les raisons de la démesure entre la surface et la population limitées de notre pays d’une part, par rapport à sa puissance économique, son rayonnement diplomatique, peu à peu étendus, d’autre part.
Le cadre temporel débute en 1857, après le Traité de Paris mettant fin à l’«affaire de Neuchâtel» avec la Prusse (consacrant la place de la Suisse sur le théâtre européen), et il se déroule jusqu’en 1914.
Tout au long de son exposé, l’universitaire s’appuie sur des faits précis, cite des extraits de documents de l’époque, mais il limite volontairement le nombre d’informations factuelles. Pour trouver davantage de détails, ce sont l’appareil de notes et la bibliographie qui ouvrent des voies vers l’approfondissement. Dans sa rédaction, Cédric Humair s’est fixé pour objectif de dégager des lignes de force: Il revendique vouloir «simplifier le récit sans sacrifier la complexité de l’histoire»1.
Développements tous azimuts
Parcourons la publication, en signalant des perspectives générales, traitées en détail dans chacun des chapitres.
Un premier axe porte sur le processus d’expansion économique. Dans ce contexte de croissance générale, notre pays se fait peu à peu sa place, sur le continent européen comme dans le reste de la planète. Même si elle n’est pas une puissance coloniale, l’auteur insiste sur le constat que la Suisse se taille de grandes parts dans différents secteurs du marché mondial. La neutralité permet, plus aisément, de tisser un réseau de relations.
Cet essor économique et financier ainsi décrit se réalise dans un contexte politique continental stabilisé et, simultanément, fragile. Certes la Suisse d’après 1848 est un Etat moderne, mieux apte à résister aux influences étrangères. Mais en même temps notre pays se retrouve entouré de puissances ne se privant pas d’affirmer leurs prétentions sur notre territoire, au nom, par exemple, du principe des nationalités. Berne y répond en défendant avec énergie la neutralité, grâce à son armée, mais aussi en se rendant utile sur le plan diplomatique (Conventions de Genève, Croix-Rouge, conférences internationales…).
Sur un autre plan, constituant un deuxième grand volet de l’étude, l’auteur rappelle, en se fondant sur des exemples, que notre pays a d’abord été dans l’orbite de la France (notamment au travers de l’«Union latine», qui a aligné les monnaies de plusieurs pays autour du franc français) puis, dès 1871, de l’Allemagne. Mais il rappelle qu’à chaque fois qu’une puissance s’est montrée trop présente, le Conseil Fédéral a pris des distances.
L’historien, après avoir mentionné tous les succès helvétiques, attire l’attention sur les fragilités de la Confédération: Les questions de l’approvisionnement en matières premières et du manque d’accès direct à la mer restent des facteurs de vulnérabilité. Et que dire de la position actuelle de notre pays face à l’Union européenne, demande l’auteur à la dernière page.
Comment lire l’ouvrage ?
Par le choix assumé de sobriété rédactionnelle, et de construction rigoureuse, le remarquable ouvrage est tout à la fois scientifique et lisible par tous. Même si ce n’est pas forcément une intention première, affichée par l’auteur, son texte peut constituer une base de travail et d’acquisition de connaissances idéales, tout aussi bien pour un étudiant en premier cycle universitaire (en histoire ou en économie), ou éventuellement pour un gymnasien/lycéen de dernière année, s’il doit mener une recherche plus approfondie dans le cadre d’un exposé ou d’un projet de recherche, comme par exemple un travail de maturité. Le prix fixé par l’éditeur en permet aisément l’achat. L’enseignant, lui, pourra trouver l’armature pour un cours qu’il pourra développer et enrichir de sources choisies à sa guise.
D’aucuns déploreront l’absence d’une iconographie, qui, bien choisie, pourrait tout à la fois véhiculer efficacement des informations résumant le propos et stimuler l’analyse. Mais l’objectif de Cédric Humair ne paraît pas être de rédiger un manuel, mais plutôt une synthèse, pouvant apparaître comme le point de départ d’une investigation plus large. Le lecteur, considérant la démarche, ne peut s’empêcher de discerner des rapprochements méthodologiques opérés avec les principes rédactionnels des meilleurs numéros de la collection universitaire française «Que sais-je?». Et cette qualité de synthèse, conjuguée avec une invitation à la réflexion, qui fait avant tout l’intérêt de cette remarquable étude d’histoire suisse.
Pierre JAQUET
Cédric HUMAIR : La Suisse et les Empires, affirmation d’une puissance économique. Neuchâtel, Ed. Alphil, (Coll Focus), 2024, 171 p.
Le pdf de ce compte-rendu peut être téléchargé ici.
1 p.13
Mise en récit d’innovations. Artefact, n° 16 – 2022
Histoire, technique et récits
Les techniques existent indépendamment des sciences, elles ne sont pas toujours une réalisation pratique du savoir scientifique.
L’historien est souvent proche du monde des lettres ou de la sociologie. S’il se consacre aux sciences, à leurs réalisations pratiques et aux techniques, c’est généralement en expert extérieur. À l’Université de Strasbourg, une équipe s’est constituée autour de ces domaines, donnant naissance, en 2013, à Artefact. Cette revue de qualité contient des analyses pointues, mais que les auteurs s’efforcent généralement d’expliciter. Leur intérêt pour les technologies se manifeste également par l’édition : comme les autres, le n° 16, paru en 2022 et ici évoqué [1], est librement disponible sur le Web.
Le centre de gravité
Cinq articles sont au cœur d’une livraison intitulée « Mise en récit d’innovations ».
Gérald Gaglio prétend mener une enquête policière pour décrire et analyser les degrés d’utilisation d’une valise en télémédecine d’urgence en « EHPAD ». L’approche, certes intéressante, est précédée de trop de propos théoriques.
Joëlle Forest, Céline Nguyen et Marianne Chouteau appréhendent la question du récit au travers de personnages impliqués dans l’innovation. Focalisées sur Saint-Gobain et la fibre de verre, elles décrivent un processus évolutif « multi-acteurs et multi-étapes ».
Dans « La Super-Cocotte et la mère Denis, récits d’innovations et arts ménagers », Aurélie Brayet interroge avec à-propos les énonciations sur ce secteur traversé par une ambivalente « tradi-modernité ». Le comment et pourquoi des discours sur une découverte, ainsi que la forme du récit, ne sont-ils pas des vecteurs d’analyse ?
Noémie Boeglin invite à passer du temps en compagnie de Georgia Knap (ou plutôt Gëorgia Knap, 1886-1946), inventeur français d’origine hongroise de la « merveilleuse et féerique maison électricité ». Les récits exhumés et analysés (articles de presse, cartes postales, catalogues ou autobiographie) relatent cette maison électrifiée, née à Troyes en 1907. La chercheuse colporte également des récits formulés par le concepteur, et la façon dont ceux-ci sont entrés en résonnance, d’abord avec un roman-feuilleton à succès – « Les Possédées de Paris » de Georges de Labruyère, publié dans « Le Matin » entre le 16 avril et le 29 août 1910 – mais aussi avec des romans de H. G. Wells ou de Jules Verne. Dans ce propos passionnant naît l’envie que plus de sources iconographiques et textuelles y figurent !
Cédric Neuman observe la mise en récit managériale des ordinateurs en France, dans les années 60 ; celle-ci a participé à la création d’une mythologie autour de l’essor de l’informatique. Apparaissent alors les éléments constitutifs du cadre d’appréhension du numérique : gestion participative et entreprise en réseau, technique des cadres et des ingénieurs, polyvalence contre spécialisation, obligation de formation permanente et de reconversion professionnelle… Au-delà de constats documentés, l’universitaire n’aurait-il pas pu proposer des hypothèses pour ouvrir un débat ?
Et encore
Quatre articles sont consacrés à l’alun au Moyen Âge. C’est une substance utilisée en peinture, en tannerie, et parfois dans les cosmétiques. Ces textes cassent des stéréotypes, notamment le talentueux travail, de Ricardo Córdoba de la Llave, sur le corps en Espagne, du XIVe au XVIe siècles : La société attachait déjà une grande importance à la santé et à l’apparence.
Retenons brièvement deux écrits, en lien avec la Suisse : l’un sur la mise en place de la loi d’invention des brevets (révélatrice de la société et de son fonctionnent politique) ; l’autre sur une exposition de porcelaine de Meissen au Musée de l’Ariana à Genève. À Meissen, on avait su percer le mystère de la fabrication découverte et exploitée par les Chinois.
Pour conclure
Ce recueil s’apprécie par son sérieux et ses riches contenus. On souhaiterait parfois lire des sources plus nombreuses et des analyses plus personnelles; les réflexions et interrogations restent donc à poursuivre et développer par les historiens auxquels cette parution est d’abord destinée.
Et après
Quelques mots sur le n° 17 [2], consacré au « Renouveau de l’histoire des instruments scientifiques ». Le concept d’industrie y est discuté : Lisa Caliste et Guillaume Carnino évoquent les chemins multiples empruntés au fil des siècles. François Jarrige étudie les sens successifs d’un mot qui « traverse l’écriture de l’histoire », « se transforme au milieu de vifs conflits sociaux. »
Jean-François Bert, évoquant une captivante exposition tenue à l’EPFL dédiée aux relations entre science et montagne au XVIIIe siècle, met en évidence tout ce qu’un observateur peut alors dire sur lui-même.
[1] Mise en récit d’innovations. Artefact, n° 16 – 2022 (Presses universitaires de Strasbourg).
https://journals.openedition.org/artefact/11820, consulté le 5 août 2022.
[2] https://journals.openedition.org/artefact/12999, consulté le 6 septembre 2023.
Pierre Jaquet, Université Populaire de Lausanne
ARCHIVES
Pensée critique, enseignement de l’histoire et de la citoyenneté, aux Editions de Boeck, rassemble les réflexions d’un panel de didacticiens sous la direction de M.-A. Ethier, D. Lefrançois et F. Audigier.
En février 2018, a paru cet ouvrage qui, par la profondeur des ses réflexions, constitue une ressource utile tant pour les enseignants que pour les didacticiens. Les uns y trouveront des démarches novatrices, les autres un approfondissement de réflexions menées depuis plus de 30 ans au sujet des buts et intentions de l’histoire enseignée.
« Peut-on former à l’esprit critique et les apprentissages scolaires peuvent-ils avoir quelque influence sur le comportement citoyen ? » Les 14 chercheurs exposent leurs réflexions pour approfondir cette question et l’éclairer par l’analyse de quelques expériences réalisées dans les classes.
Cet ouvrage situe l’esprit critique découlant de l’histoire enseignée, et s’inscrit aussi dans le débat portant sur l’éducation à la citoyenneté. Il nous prépose de réfléchir aux liens entre histoire académique, histoire scolaire et « histoire du 3e type », à savoir celle qui est issue tant de la mémoire familiale, des médias sociaux que des films ou jeux vidéos d’histoire.
L’ouvrage se décline en 3 parties. Dans un premier chapitre, une réflexion épistémologique, élaborée avec brio par François Audigier, introduit des réflexions issues de analyses d’enquêtes, de leçons, et de l’utilisation de vidéos et de jeux historiques en classe d’histoire
Dans un 2ème temps, au fil des pages, cet ouvrage de pédagogie questionne la place de la critique en cours d’histoire, tant dans la conscience historique des élèves, dans les pratiques pédagogiques que par l’usage du cinéma et des jeux vidéos.
Dans un entretien, François Audigier évoque ce rapport entre histoire et esprit critique.
http://www.cafepedagogique.net
Il y relève que dans l’enseignement de l’histoire, « Une des difficultés tient spécialement à la tension entre les deux finalités de cette discipline qui sont, l’une de transmettre un ou des récits qui inscrivent les élèves dans un sentiment d’appartenance à une communauté politique, l’autre, justement, d’éduquer à la pensée critique. La première suppose l’adhésion, la seconde une mise à distance. » François Audigier ajoute qu’il est possible, et plusieurs chapitres de l’ouvrage le montrent, de mettre l’élève en position de « distanciation critique ».
Dans un 3ème temps, deux contributions explorent l’utilisation pédagogique qui peut être faite des matériaux numériques, avec le cinéma et les jeux vidéos.
Ainsi, dans le dernier chapitre, Vincent Boutonnet démontre ainsi comment l’analyse d’un jeu comme « Assassins’s Creed » peut se faire en relation avec des sources historiques. La séquence ainsi proposée permet une analyse des représentations de l’histoire en relevant les erreurs factuelles glissées dans le jeu. Déceler ces erreurs et les manipulations faites par l’éditeur sont l’occasion d’apprendre, développer et exercer la « pensée historique.
Cet ouvrage marque une étape dans l’affinement des réflexions sur les finalités de l’enseignement de l’histoire, il témoigne aussi, et c’est important, de pratiques innovantes en cours d’histoire. « L’exercice critique dans l’enseignement de l’histoire remet aussi en cause une conception traditionnelle de l’histoire événementielle, avec ses grandes dates, ses récits, son panthéon et ces figures tutélaires » et ainsi « la compétence critique en histoire est un élément central de la formation à la vie morale et politique avec autrui […]. Elle contribue à la formation du citoyen qui saura « faire valoir des options politiques, économiques et sociales par des moyens autres que les simples rapports de force … »
avril 2018
Europa, notre histoire : l’héritage européen depuis Homère, ouvrage collectif édité par Etienne François et Thomas Serrier. Les Arènes, 2017 sous la direction d’Etienne François et Thomas Serrier
Cet ouvrage collectif, paru en septembre 2007 séduit par la richesse de son propos, la multiplicité des auteurs et de leurs approches. Il rassemble le travail de 109 historiens, de toutes nationalités, dont un bon nombre de français, qui ont œuvré sous la houlette d’Etienne François et Thomas Serrier.
Le lecteur sera séduit par la richesse de l ‘ouvrage qui rassemble des contributions d’historiens réputés, par la multiplicité des apports et des regards, la richesse du contenu, et l’unité de l’ensemble. « Penser notre histoire aujourd’hui, c’est la penser avec l’Europe, dans la durée et ensemble» « les conflits de l’histoire récente dominent nos mémoires », mais l’héritage européen lui, vient de très loin ». Ainsi, l ’ouvrage est présenté comme une « enquête « ouverte au grand large » (p. 12). Il est le fruit de multiples rencontres entre les auteurs qui tous, explorent les liens avec l’Europe d’une thématique, d’un lieu, d’une religion, d’un objet (la kalachnikov), de pays ou « continents » (Inde Afrique, ..), ou la place de la grève, de l’homosexualité, de l’empreinte des femmes, ou d’un homme comme Napoléon dont la « mémoire a eu tendance à s’estomper au fil du temps» (p. 813).
L’ouvrage est structuré en 3 parties : « présence du passé », « Les Europes » et « Mémoires monde ». Le premier « pôle », qui porte sur la « Présence du passé », s’ouvre d’abord par une large place aux grands conflits, aux brûlures qui ont déchiré le continent puis se poursuit par les récits et croyances qui ont contribué à renouer les liens entre les peuples. « Ecole de guerre devenue école de paix, l’Europe tente de déposer […], le chapeau noir du passé » (p. 185). Le second « pôle » « Les Europes », « par à la recherche d’une géographie des mémoires », « figures, lieux et espaces, mythes et représentations ». Les contributions du troisième « pôle » étudient « l’imbrication qui existe dès l’origine entre l’Europe et un monde en mouvement » (p. 14)
Dans la troisième partie « Mémoires monde », les contributions « explorent les chemins, […] reliant les mémoires européennes à l’histoire mondiale. Elles mettent en évidence l’impossibilité de définir les espaces mémoriels européens uniquement de l’intérieur. Le regard porté depuis l’extérieur a toujours compté dans l’image que l’Europe se fait d’elle-même » (p. 949)
Le lecteur l’aura compris, les auteurs interrogent de manière récurrente les liens que les Européens entretiennent avec leur passé, un passé fait de conflits, de mythes, de villes et d’idées ainsi que les liens que les Européens ont noué avec les autres sociétés humaines.
Et cet héritage reste vivant. Ainsi, l’article consacré aux Lumières s’achève, en conclusion, sur la réflexion que « les Lumières ne sont pas ne sont pas arrivées à leur terme … elles continuent d’inspirer tous ceux qui luttent … en faveur des libertés individuelles » (240). Ailleurs, John Tolan interroge les liens entre l’Europe et « l’islam, le même et l’autre de l’Europe » (p. 387). Sa réflexion court des écrits de st Jérôme au IVe siècle aux propos de Geert Wilders (p. 391) et s’attarde sur les multiples représentations que les Européens ont élaborées de l’islam, faites de préjugés autant que de fascinations. L’islam, « on finit toujours par parler de lui quand on cherche à définir l’Europe (p. 403)
Chaque article est ainsi rédigé par un spécialiste: John Tolan pour le rapport de l’Europe à l’islam, à Rémi Brague la philosophie, à Alessandro Barbero les croisades, à Jay Winter la Première Guerre mondiale, à Johann Chapoutot le nazisme, et Sanjay Sabrahmanyam pour le rapport de l’Europe au monde, mais le luxe pour Franco Cardini ; interviennent encore Patrick Boucheron, Timothy Brook, Enzo Traverso, Pap Ndiaye, etc .. une cohorte d’historiens réputés, qui, chacun dans sa spécialité, interroge l’histoire de l’Europe et le rapport du continent à son passé, selon une perspective d’histoire large, interrogeant les mémoires, faisant ressortir les emprunts, les reniements, les ruptures, les continuités « l’histoire éternelle, interminable, de la vanité,, du luxe, du plaisir, depuis toujours vilipendés parles religieux et les moralistes (Franco Cardini, p. 1283)
La disparité apparente des contributions est contenue par la volonté des auteurs de faire apparaître, par leur réflexion, ce qui rapproche et uni les sociétés européennes.
L’enseignant y trouvera de nouveaux cheminements, empruntant souvent l’histoire longue, qui éclairent souvent d’une lumière nouvelle des thématiques connues. Il sera sensible au désir de relier les sociétés européennes par ce qui les a si souvent séparées : leur histoire.
27 mai 2018
Deutschland und Frankreich – Geschichtsunterricht für Europa / France – Allemagne. L’enseignement de l’histoire pour l’Europe, Wochenschau Verlag, mars 2018.
Ce volume, introduit par Etienne François, et postfacé par Philippe Joutard, offre 21 réflexions sur l’enseignement de l’histoire, fruit de deux colloques franco-allemands.
« Ce livre commun aux associations professionnelles d’Allemagne et de France souhaite promouvoir, dans une démarche fondatrice, une Europe de la paix et du savoir partagé, particulièrement auprès des enseignants d’histoire, de géographie, d’allemand et en classes européennes. »
https://www.aphg.fr/France-Allemagne-L-enseignement-de-l-histoire-pour-l-Europe
31 mai 2018
Cahiers pédagogiques N° 546 – L’histoire à l’école : enjeux, dossier coordonné par Alexandra Rayzal et Benoit Falaize juin 2018
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Histoire-plurielle-passes-singuliers
13 juin 2018
Quels liens peut-on faire entre les différents empires eurasiatiques, la Rome impériale et surtout notre monde actuel ? Un livre d’un auteur américain nous donne quelques réponses. KUMAR, Krishan (2017). Visions of Empire : How Five Imperial Regime Shaped the World. Princeton : Princeton University Press.
Cet ouvrage, sur les différents empires de l’époque contemporaine, permet d’avoir une bonne idée sur l’importance qu’eurent ceux-ci pour la formation du monde d’aujourd’hui. En partant de l’Empire romain, Krishan Kumar tire de nombreux parallèles entre cette période historique et les empires qui lui succédèrent au cours de l’époque contemporaine. Cela permet d’avoir une bonne image de la forme que prirent ces empires et de pouvoir les comparer entre eux.
Tout au long de son ouvrage, K. Kumar décrit patiemment ces monstres eurasiatiques et décrit également les incidences possibles qu’ils ont encore dans les pays qui ne sont aujourd’hui plus sous l’emprise de ces puissances coloniales. Des grands bouleversements, aux batailles, en passant par la diplomatie ou la religion de ceux-ci, il trace des jalons scientifiques pertinents pour la lecture du monde actuel en expliquant le fonctionnement politique des populations, leur langue commune, leurs liens avec la métropole, l’influence qu’ils eurent sur leur circuit économique, ou encore le ressentiment que certains pays ont gardé face aux puissances impériales eurasiatiques.
D’un niveau pédagogique, ce pavé de plus de 500 pages permet d’avoir une vue d’ensemble de ces empires et de leurs influences de manière structurée. Le livre se divise en plusieurs chapitres qui renvoient uniquement à une forme impériale : à la présentation de l’empire romain se succèdent les empires ottoman, austro-hongrois, russe, britannique et français. Cette organisation permet de ne s’attarder que sur une forme d’empire ou d’en choisir plusieurs sans pour autant perdre d’intelligence au propos. En outre, les sous-chapitres permettent de s’attarder sur un aspect en particulier : les liens au sein du chapitre ne sont pas si nombreux, tout au plus ils peuvent être répétés.
Certes sans le vouloir absolument, son ouvrage permet différentes attaques possibles, comme celle liée à la géographie ainsi qu’au développement durable. Néanmoins, celles-ci ne peut se faire que si une lecture attentive est réalisée et en fonction d’axes variés (économique, en soulignant l’importance des débouchés que revêtent les colonies pour l’industrie de la métropole ; géographique, avec les nombreux déplacements des colons ; etc.). En écrivant sur l’empire britannique par exemple, K. Kumar souligne qu’« il y avait (au début du XXe siècle) le travail d’un Conseil Marketing d’Empire, qui faisait des produits impériaux – le thé de Ceylon, le cacao de la Côte d’Or, le beurre de Nouvelle Zélande – des produits familiers dans les maisons britanniques. » En poursuivant par le fait que « l’empire n’avait pas été plus matériel, si ce n’est un corps en soi. » (p. 353) En rendant ainsi les produits des pays impériaux suffisamment intéressants pour un consommateur britannique, la mondialisation a pu alors poser ses premiers jalons.
Enfin, le livre, bien qu’écrit en anglais, se laisse lire assez facilement et laisse une bonne appréhension des époques coloniales européennes et d’Asie mineure. Krishan Kumar tente de reste neutre dans ses propos et cela est plutôt bien réussi. Un ouvrage passionant, qui mérite de trôner dans toutes bibliothèques d’enseignant en histoire !
9 juillet 2018
« L’histoire, entre enseignement et recherche », Par Etienne Anheim et Bénédicte Girault, in : Annales. Histoire, Sciences Sociales 2015/1 (70e année)
Cet article s’attache à mettre en rapport la didactique de l’histoire-géographie et les enjeux de la recherche dans ces deux disciplines. Il invite à réfléchir au lien entre le savoir que le professeur transmet à ses élèves et la mise en œuvre de la recherche comme savoir-faire, voire comme savoir-être. Après un éclairage sur la formation actuelle des enseignants, l’auteure, professeure de collège, explique à travers quelques situations d’enseignement concrètes la nécessité de rendre l’élève acteur de son apprentissage et de le former à une méthode de recherche.
Christopher Alan Bayly, La naissance du monde moderne (1780-1914), traduit de l’anglais par Michel Cordillot, préface de Eric Hobsbawn. Paris, 2007
Traduction de : The Birth of the Modern World 1780-1914, 2004
Pour en lire une recension : https://journals.openedition.org/rh19/1632
Jurgen Osterhammel, La transformation du monde : Une histoire globale du XIXe siècle, Paris, 2017
Traduction de : Die Verwandlung der Welt, 2009
Histoire du monde au XIXe siècle, sous la direction de Sylvain Venayre et Pierre Singaravelou, Fayard, 2017
Première approche
Cet ouvrage s’articule en trois parties
Une première partie: l’expérience du monde « iù l’on découvre que la mondialisation ne fut pas un processus univoque d’occidentalisation »
Une première partie: les temps du monde « où l’on observe que certains événements – mais pas tous – résonnèrent pour la première fois à travers l’ensemble du globe »
Une première partie: le magasin du monde « Où l’on trouve des productions étranges ou familières, qui colonisèrent les espaces publics et domestiques »
Dans cet ouvrage transparaît une volonté d’élargir le champ de l’histoire de l’Europe à la totalité du monde. Ainsi, des thématiques habituelles au lecteur européen, telles les migrations, prennent un autre relief lorsque les migrations transatlantiques sont comparées aux migrations asiatiques, d’ampleur comparable. Ainsi, les auteurs font le choix d’une histoire mondiale qui fait place, aux côtés de l’écrit, à l’oralité, dominante dans plusieurs sociétés extra-européennes, et dans la partie du livre intitulée « «Le magasin du monde » à des objets représentatifs.
Le lecteur pressé peut consulter une interview accordées par les éditeurs dans Libération du 29 septembre 2017 [consultable en juin 2018]
Sylvain Venayre et Pierre Singaravélou «Le XIXe siècle n’a jamais eu autant de choses à nous dire», Libération, 29.09.2017
http://www.liberation.fr/debats/2017/09/29/sylvain-venayre-et-pierre-singaravelou-le-xixe-siecle-n-a-jamais-eu-autant-de-choses-a-nous-dire_1599822
« Comment faire une histoire mondiale du XIXe siècle alors que le XIXe siècle n’a pas eu lieu partout dans le monde ?
« Le reste du monde continue à nommer le temps autrement jusqu’à la standardisation de la fin du XIXe siècle : les musulmans avec le calendrier de l’hégire, les Chinois avec les calendriers dynastiques, les Indiens avec le calendrier hindou, etc. Ce qui pose une question : au fond, qu’est-ce que le XIXe siècle ? »
« Si on veut l’analyser à l’échelle du monde, le «XIXe siècle» doit être une découpe arbitraire du temps, au même titre que le «XVe siècle», par exemple, qui n’avait aucune existence au XVe siècle. Pourtant, il est clair que quelque chose s’est passé quelque part entre 1800 et 1900 : l’invention de la contemporanéité »
La «modernité» est une catégorie piégée … c’est une valeur essentiellement occidentale, qui a éclipsé d’autres formes de modernité dans d’autres parties du monde
« S.V. : Nous en sommes convaincus : ce XIXe siècle n’a jamais été aussi proche de nous »
Recension d’un colloque
Table ronde : Histoire du monde au XIXe siècle
Cette table ronde, organisée par le CHRIM (centre d’histoire internationale et d’études politiques de la mondialisation), réunissait plusieurs intervenant·e·s invité·e·s autour d’une discussion du nouvel ouvrage codirigé par Pierre Singaravélou et Sylvain Venayre : L’histoire du monde au XIXe siècle. Les deux codirecteurs souhaitaient par ce livre présenter une nouvelle façon de parler du XIXe siècle. Partant d’une rencontre avec le médiéviste Patrick Boucheron, ils ont imaginé proposer le même type d’ouvrage que ce dernier, mais pour la période du XIXe.
http://Table ronde : Histoire du monde au XIXe siècle
22 août 2018
Peter Frankopan, Les routes de la soie, trad. de l ‘anglais, Nevicata, 2017
Cet ouvrage ne porte pas tant sur l’histoire que l’on pourrait faire des « routes de la soie » que sur les pays et peuples se trouvant entre Europe et Chine : Moyen-Orient, péninsule indienne, Asie centrale. C’est un essai d’histoire globale, relisant celle-ci du point de vue de ces peuples.Une lecture novatricePour les recensions, parfois critiques, voir https://blogs.letemps.ch/dominique-de-la-barre/les-routes-de-la-soie / https://www.la-croix.com
Dans les manuels scolaires, l’histoire et la géographie ne sont souvent qu’un récit autocentré de l’essor de l’Europe, de la Grèce antique à la révolution industrielle du XIXe siècle. Aujourd’hui encore, l’importance de « la Méditerranée, berceau de la civilisation », fait partie des clichés les mieux partagés du discours politique. L’historien Peter Frankopan élargit la perspective en regardant le passé du monde à partir de son « milieu », cet espace qui court des rives orientales de la Méditerranée jusqu’à l’Himalaya, véritable « axe de rotation du globe », de l’Atlantique au Pacifique. (…)
https://www.theguardian.com
et une interview de l’auteur
https://perspectives.pictet.com
Didier Gagnadou, La diffusion des techniques et les cultures, Paris, Kimé, 2008
Didier Gagnadou, Diffusion of techniques, Globalization and Subjectivities, Paris, Kimé, 2017
7 septembre 2018
Esquisse de démarches pour un enseignement de l’histoire du Moyen-Orient aux XXe et XXIe siècle : quelques réflexions issues des ouvrages de Jean-Pierre Filiu dont Généraux, gangsters et jihadistes (2018), et Les Arabes, leur destin et le nôtre (2015)
Depuis 25 ans, l’histoire des sociétés arabes et moyen-orientales intrigue, intéresse ou inquiète. Historiens, sociologues, chercheurs et journalistes scrutent ces sociétés, tentant de les décrire tant dans leur diversité que dans les mouvements de fond qui les agitent : adaptation à la modernité, importance du pétrole comme ressource énergétique mondiale, croissance démographique, revendications sociales, interventions militaires étrangères – notamment euro-américaines, place de l’islam dans la société, et plus récemment l’influence du climat dans l’évolution sociale. Ces soubresauts s’accompagnent d’un épuisement des multiples discours – nationalistes, marxistes, islamistes – qui ont tenté de redonner à ces sociétés une place dans le monde. Nulle fatalité ne poursuit pourtant le Moyen-Orient, longtemps un acteur majeur de l’économie monde, progressivement affaibli et isolé tant par l’émergence de l’Europe comme première puissance maritime mondiale au XVIIe siècle.
Plus récemment, les conflits et révolutions qui ont secoué nombre de pays arabes depuis 2011 ont surpris la plupart des historiens. Les destructions et l’exode des populations qui les ont suivies interpellent et suscitent interrogations et publications. Dès lors, une place ne doit-elle pas être faite au Moyen-Orient dans les programmes d’enseignement de l’histoire? Sur quelle temporalité, par quelles problématiques, avec quels moyens, et pour quel public?
Dans son dernier ouvrage, Jean-Pierre Filiu propose de lire les événements dès les années 1970 à ce jour comme produit des efforts des oligarchies, venues au pouvoir après le début des années 1970, qui instrumentalisent, voire génèrent la « menace jihadiste » pour justifier leur captation du pouvoir et des richesses de leur pays aux dépens des populations civiles. De plus, la plupart des pouvoirs en place ont surmonté, pour l’instant, la révolte de leurs citoyens, et perdurent ainsi des régimes autoritaires qui favorisent voire attisent les mouvements violents et identitaires.
Le modèle explicatif auquel se réfère l’auteur repose sur l’exemple des mamelouks, ce corps d’esclaves turcs affranchis, qui ont dirigé l’Egypte pendant deux siècles, et ont encore perduré sous domination ottomane jusqu’à l’aurore du XIXe siècle. Ceux-ci dirigeaient et protégeaient le pays, mais vivaient à l’écart de la population, pour exercer le pouvoir dont ils tiraient profit pendant des siècles.
Cette comparaison convainc en partie, faisant écho à la « nouvelle forme de brutalisation des sociétés du Moyen-Orient » remarquée par plusieurs auteurs[1]. Encore qu’il soit permis de douter que la domination des peuples moyen-orientaux par ces pouvoirs en place perdure aussi longtemps que celle exercée par ces mamelouks. Un enseignement d’histoire doit donc explorer l’origine de ces pouvoirs.
Ainsi, toute étude de l’histoire de ces peuples demande à être contextualisée, éclairée dans ses rapports avec l’Europe et sa propre histoire pour en faire ressortir la richesse et la diversité[2]. Ainsi, comprendre le passé devrait aider nos élèves à mieux comprendre le présent et espérer de l’avenir, car «faire de l’Histoire, c’est lutter contre l’arrogance du présent, et que le présent n’a pas toujours raison par rapport au passé[3] ».
Jean-Pierre Filiu, à travers Généraux, gangsters et jihadistes, propose ainsi une première grille d’explication des 45 dernières années. Un de ces ouvrages précédents, les Arabes, leur destin et le nôtre, en 2015, adopte une focale plus large, retraçant l’histoire du Moyen-Orient, et ses liens avec l’Europe pendant les deux dernières siècles. En 7 chapitres : 24 pages pour le XIX e siècle, pour environ 150 pour le XXe siècle, il résume l’évolution du monde arabe et ses relations avec les pays occidentaux.
Ce dernier ouvrage constitue une riche introduction à l’histoire du Moyen-Orient, et l’enseignant y trouvera des premières pistes de travail pour l’histoire du Moyen Orient et de ses relations avec l’Europe. Le recours à un enseignement d’histoire reposant sur 2 siècles nous semble indispensable, tant abondent les occasions où les peuple « d’Occident » et « d’Orient » ont semblé se rapprocher et s’opposer. S’esquisse ainsi une histoire connectée de l’Europe et du Moyen-Orient ; un sujet délicat que risquent peu d’enseignants, tant il s’éloigne de l’histoire des sociétés européennes. Mais l’enseignement de l’histoire ne vise pas seulement à transmettre des récits qui inscrivent les élèves dans un sentiment d’appartenance à une communauté politique, mais aussi à élargir l’horizon de leur pensée, à les ouvrir « sur les relations avec le reste du monde », et à « prendre en compte la diversité des mémoires, d’insister sur les classes et groupes dominés[4]».
En effet, Jean-Pierre Filiu décrit un long XIXe siècle avec la renaissance arabe, la nahda inspirée d’un premier face à face du monde arabe avec l‘Europe, qui est suivi du choc de la Première Guerre mondiale et des traités de paix. Ces traités établissent la domination européenne sur les peuples arabes, une période coloniale suivie de la longue lutte pour l’indépendance de ces peuples[5] ; de la création d’Israël et la nabka, l’exil des Palestiniens. Au XXe siècle, Les guerres israélo arabes, puis la « menace jihadiste », favorisent l’instauration de régimes autoritaires bénéficiant d’une aide étrangère. Une période d’apparente stagnation s’installe, agitée par les multiples conflits apparus après 2011.
Cette approche politique et événementielle gagnerait à être complétée tant par un recours à l’histoire sociale, qu’à l’histoire des cultures. Ainsi, l’évolution démographique des sociétés moyen-orientales constitue un premier angle d’ approche. Durant tout le XIXe siècle, les populations du Moyen-Orient connaissent une rapide croissance démographique : de 1800 à 1900, la population égyptienne passe de 4 à plus de 9 millions d’habitants, pour plus de 95 millions en 2019. Les villes dont Alexandrie et Alep se développent, modernisent leurs infrastructures. La cohabitation entre plusieurs religions ou communautés religieuses, au statut certes inégal, était traditionnelle au Moyen-Orient – mais inconnue en Europe, elle est fragilisée par l’influence des idées européennes (nationalisme), et l’instrumentalisation des minorités par les puissances européennes[6].
Par ailleurs, de multiples migrations scandent cette région depuis les reculs de l’empire ottoman aux XVIIIe et XXe , siècle les échanges de population au début des années 20 du XX e siècle, les multiples exils des Palestiniens, et les migrations importantes de populations vers l’Amérique du sud, les USA, l’Afrique et l’Europe.
L’évolution sociale – l’amélioration de la situation de la femme, le passage d’une société partiellement pastorale à une société majoritairement sédentaire et urbaine, l’introduction et l’appropriation des inventions occidentales et l’alphabétisation progressive, ces études menée comparativement à l’évolution des sociétés européennes, serait un deuxième aspect de compréhension.
En plus, l’étude des échanges techniques et scientifiques nous montre d’autres liens : le savoir scientifique venant du Moyen-Orient à l’Europe du XIe au XIIIe siècle[7], puis se dirigeant dans le sens inverse ; des pays occidentaux aux pays moyen-orientaux du XIXe siècle à ces dernières années. Leur étude permettrait d’établir les solidarités qui ont lié et lient encore des sociétés trop souvent considérées comme antagonistes. Les échanges et influences culturels, incessants seront aussi un point d’accroche fécond auprès d’adolescents, leur montrant des parentés contemporaines dans les domaines artistiques, littéraires et musicaux.
Une étude, succincte, de l’islam élargira ces premières réflexions. Ainsi l’islam a assuré la cohésion de ces sociétés, mais ces sociétés recherchent aussi un accès à la modernité au-delà du référent musulman[8]. Toute approche de l’islam ne sera bénéfique que si l’enseignant ne le stigmatise pas, et qu’une causalité première n’est pas accordée aux discordes entre chiites et sunnites dans les conflits actuels[9].
La démarche par enquête reposerait par la mise à disposition, aux élèves, d’un choix de sources textuelles, iconographiques et documentaires riches et diversifiées[10]. L’enseignant fixera son choix selon le temps disponible grâce aux articles et ouvrages accessibles. Sa propre maîtrise du sujet, lui permet, dans un premier temps, à adopter une focale aussi large que possible. Il fera des choix, ses choix, en privilégiant des points de vue et des approches multiples.
Enfin, tout enseignement de l’histoire du monde arabe et du Moyen-Orient est amené à tenir compte de la nahda, soit des tentatives entreprises depuis 1820 pour moderniser les provinces de l’empire ottoman, puis les Etats semi-indépendants apparus après 1919. Ces efforts ont pu bénéficier des liens tissés avec l’Europe, des échanges entrepris, des visites comme celle des étudiants égyptiens emmenés en France dès avant 1830 avec Rifa’a a- Tahtawi. Le développement de l’imprimerie et de la presse touche, quant à eux, vers 1900, un large public et favorise l’éducation et la diffusion du savoir[11]. Par ailleurs, la prise de conscience d’un retard à rattraper et du risque d’une invasion étrangère a aiguillé les réformes en Egypte, Tunisie et dans l’empire ottoman, comme au Japon ou en Chine[12]. Mais la colonisation européenne va entraver ces efforts et affaiblir l’attrait d’un modèle européen.
Il serait présomptueux de présenter ces quelques lignes comme un programme permettant d’effacer des décennies d’incompréhension mutuelle entre l’Europe et le monde arabe. Mais l’élargissement du monde avec l’indépendance des peuples coloniaux demande corolairement un élargissement de l’imaginaire de nos élèves. L’abondance des sources et de la documentation, le savoir faire des enseignants en histoire, devront permettre à leurs élèves de mieux découvrir une région et des peuples dont la souffrance est parvenue jusqu’à nous. La difficulté d’affronter l’histoire du « Moyen-Orient compliqué » ne doit pas rebuter, car « l’idée de civilisation implique donc que les êtres humains ont des cultures différentes, puisque c’est justement lorsqu’il y a cultures différentes, que nous pouvons juger les attitudes des uns envers les autres. »[13]
Emen, décembre 2018
[1] Le Moyen-Orient, fin XIXe-XXe siècle, éd. Leila Dakhli, Paris, Seuil, 2016, p. 27 ; Amit Bozarslan, Révolution et état de violence Moyen-Orient 2011-2015, Paris, 2015 ; Jean-Pierre Filiu, Les Arabes, leur destin et le nôtre : histoire d’une libération, Paris, 2015, pp 240-242.
[2] Voir Jean-Pierre Filiu, Les Arabes, op.cit., pages 97-98 ; pour la période coloniale, Jérôme Ferrari et Oliver Rohe, À fendre le coeur le plus dur, Paris, 2015, ouvrage présenté par Grégoire LEMenager, « Quand on civilisait les Arabes », in Le Nouvel Observateur, décembre 2015 [consulté en décembre 2018]
[3] Patrick Boucheron, entretien accordé au Monde, 15 mars 2016
[4] Audigier, François, Pensée critique, pensée historienne et enseignement de l’histoire et de la citoyenneté, Paris, 2018
[5] Les multiples révoltes contre le colonisateur dès 1919 en Egypte, puis en Irak, Syrie, Palestine ; voir Filiu, les arabes, pages 96-97, voir aussi FERRARI, op. cit.
[6] Jean-Pierre FILIU, Le miroir de Damas: Syrie, notre histoire, Paris, 2017 ; Hamit Bozarslan « Au nom de la science », in l’Histoire, 408 (2015) p. 58-71, Hamit Bozarslan, Une histoire de la violence au Moyen-Orient : de la fin de l’Empire ottoman à Al-Qaida, Paris, 2008.
[7] VERNET, Juan, Ce que la culture doit aux Arabes d’Espagne, Paris, Sindbad, 1985 ; DYE, Guillaume, “les Grecs, les Arabes et les « racines » de l’Europe“, in : revue belge de philologie et d’histoire, vol.87, 2009, pp. 811-835.
[8] Abdelwahab MEDDEB , Du choc des civilisations au choc des interprétations, conférence, 4 décembre 2010
[9] Pour toute réflexion sur l’islam, voir George Corm, La nouvelle question d’Orient, Paris, 2017, pages 101-103, et p. 169, Mezghani Ali, L’État inachevé : la question du droit dans les pays arabes. Paris, 2011. Pour l’enseignement des religions, voir Anne Raymonde de Beaudrap, (dir.), Enseigner les faits religieux en classe de français. Etat des lieux, paradoxes et perspectives, INRP, coll. « Didactiques, apprentissages », Paris, 2010 ; et Séverine Desponds, Revue de didactique des sciences des religions : recherche – didactique – enseignement, No 2 (2016) « Ethique et cultures religieuses en tension ».
[10] Un choix de sources est proposé par Anne-Laure Dupont dans Le Moyen-Orient par les textes, Armand Colin, 2011. Deux documentaires: Mathilde Damoisel, La fin des Ottomans, Arte, 2015 ; Mahmoud Hussein, Philippe Calderon, Lorsque le monde parlait arabe, [film documentaire], 2001.
[11] Pour la nahda, Georges Corm, Pensée et politique dans le monde arabe : contextes historiques et problématiques, XIXe – XXIe siècles, Paris, 2015, pages 119 à 129, Christopher de BELLAIGUE, « La comète de Halley, Darwin et le grand mufti », in Books, (février 2016). Comme sources, voir notamment : Rifâ’a Al-Tahtâwî, L’Or de Paris, Paris, 2012 ; Abd al-Rahman al-Kawakibi, Du despotisme et autres essais, Paris, 2013.
[12] Pierre-François Souyri, Moderne sans être occidental. Aux origines du Japon aujourd’hui, Paris, 2016 ; Alain ROUSSILLON, Identité et modernité, les voyageurs égyptiens au Japon (XIXe-XXe siècles), Paris, 2005.
[13] Todorov Tzvetan, « Revue Hommes et Migrations. Pluralité des cultures, unité de la civilisation ». In: Hommes et Migrations, hors série (novembre 2008), pp. 9-19
Emen, décembre 2018